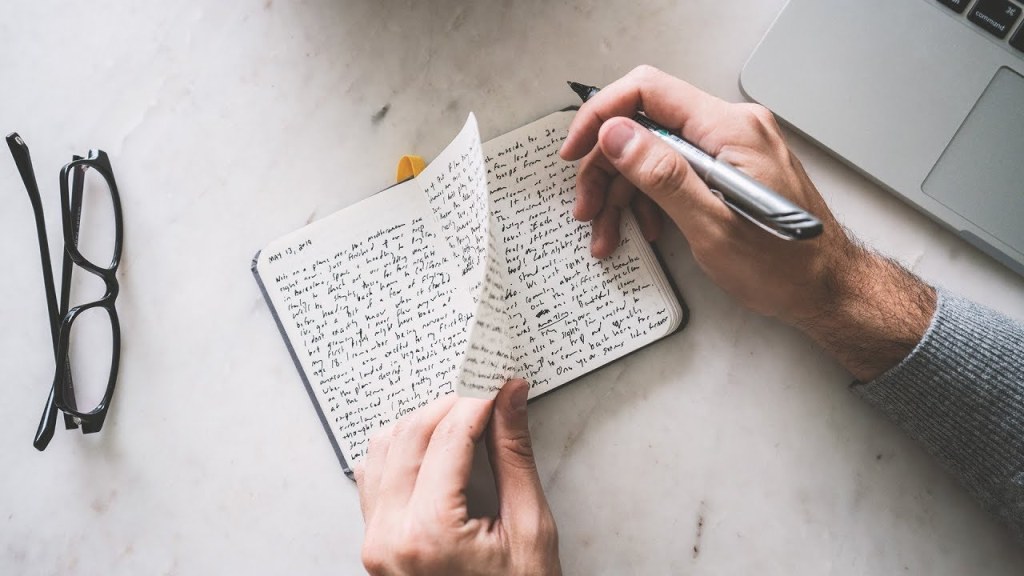
L’histoire de vie, comme le journal, peuvent être des outils qui permettent de construire des liens entre des choses, des évènements, des concepts. Comme nous le raconte Rémi HESS dans son livre « La pratique du journal, l’enquête au quotidien » ( Ed. Téraèdre): il s’agit de garder une trace de la succession des choses que l’on fait, que l’on vit que l’on découvre…«

Que pouvons-nous écrire? on n’écrit que ce que l’on vit et ce que l’on ressent. le principal sujet c’est donc la vie, notre vie. Guy de Maupassant dans la préface de « Pierre et Jean » nous déploie son explication très efficace de la vie: La vie, écrit il, est composée des choses les plus différentes, les plus imprévues, les plus contraires, les plus disparates; elle est brutale, sans suite, sans chaîne, pleine de catastrophes inexplicables, illogiques, et contradictoires qui doivent être classées au chapitre des faits divers.[…]… La vie encore laisse tout au même plan, précipite les faits ou les traîne indéfiniment.
Ainsi écrire est un projet d’action émancipatrice.
Plusieurs courants de recherche et de pratique de l’histoire de vie, peuvent être notés:
– Le premier courant correspond à L’association internationale des histoires de vie en formation ( ASIHVIF): Les praticiens et les chercheurs qu’il regroupe, se définissent essentiellement dans leur rapport au champ de la formation, plus particulièrement de la formation pour adultes. Avant d’être institué définitivement par Gaston PINEAU, Pierre DOMINICE, Guy DE VILLERS et Guy JOBERT, le courant de l’histoire de vie a été marqué par deux initiatives individuelles qui les ont précédé:
– En France Henri DESROCHE ( 1914-1994) a crée la démarche de l’autobiographie raisonnée comme méthode d’accouchement ou de maïeutique de projets de recherche portés par des adultes. Alex LAINE , docteur en sciences de l’éducation, dans son livre Faire de sa vie une histoire , nous explique que la méthode de DESROCHE a le souci d’aider celui qui le consulte à identifier le projet qui est le sien et qui est rarement tout à fait clair en son esprit. c’est à cette fin que le porteur du projet est invité à dire et travailler son parcours , ses expériences.
Pour précision la maïeutique est la méthode utilisée par Socrate pour faire accoucher les âmes de ses vis-à-vis des savoirs dont ils étaient porteurs à leur insu , et cela par l’intermédiaire du dialogue et du questionnement socratiques.
– De son côté Gaston PINEAU va axer sa recherche sur la valeur d’autoformation que contiennent la vie quotidienne et l’expérience ordinaire. A savoir que le sujet ne se forme jamais aussi bien et aussi pleinement que lorsque le processus de formation procède d’un projet dont il a lui-même décidé. Elle contient l’idée que plus le sujet a identifié ce qui a été formateur par le passé, plus il est en mesure de se former et de s’autoformer dans le présent et l’avenir. C’est le mélange d’une identification à la fois de ce que j’ai appris et de la manière dont je l’ai appris.
Comme je l’ai écrit plus haut, l’histoire de vie s’inscrit dans le processus de formation pour adultes.
Dans l’ère du « prêt-à-former » que nous traversons, Les histoires de vie sont des cibles privilégiées dans la quête des nouveaux instruments du marché de la formation pour adultes. Alex LAINE invite à ne pas se laisser happer par une approche toute techniciste des histoires de vie. il invite à prendre en compte un certain nombre de précautions et de dispositions méthodologiques et déontologiques. Alex LAINE évoque particulièrement dans la « guidance » d’histoires de vie à marche forcée avec une démarche que l’on impose aux publics visés sous prétexte que c’est bon pour eux, en ne leur donnant ni la possibilité de refuser de s’y engager, ni la possibilité de négocier les modalités techniques et déontologiques de leur implication.
Ainsi écrire doit rester une proposition et un acte libre , tout comme le choix de partager l’écrit ou pas.
L’acte émancipateur réside dans cette liberté et dans la conscientisation qui en découle. On apprend moins lorsqu’on est guidé, on apprend davantage lorsqu’on est en roues libres et avec un savoir non induit par une autre personne. L’art de la formation et de l’enseignement reste un art complexe. Il reste toujours important de bien choisir son formateur en la matière. Celui qui nous permettra de révéler notre propre savoir et non le sien.
Moins je sais ce dont je suis capable, moins je puis le mettre en œuvre et plus je suis soumis à la représentation dominante du savoir académique. Dès lors, au contraire, que je reconnais la valeurs de mes savoirs et de mes expériences, j’entre dans ce processus d’autoformation que Gaston PINEAU définit comme processus d »appropriation de son pouvoir de formation, mais qui est aussi appropriation de son pouvoir de création et d’autocréation.